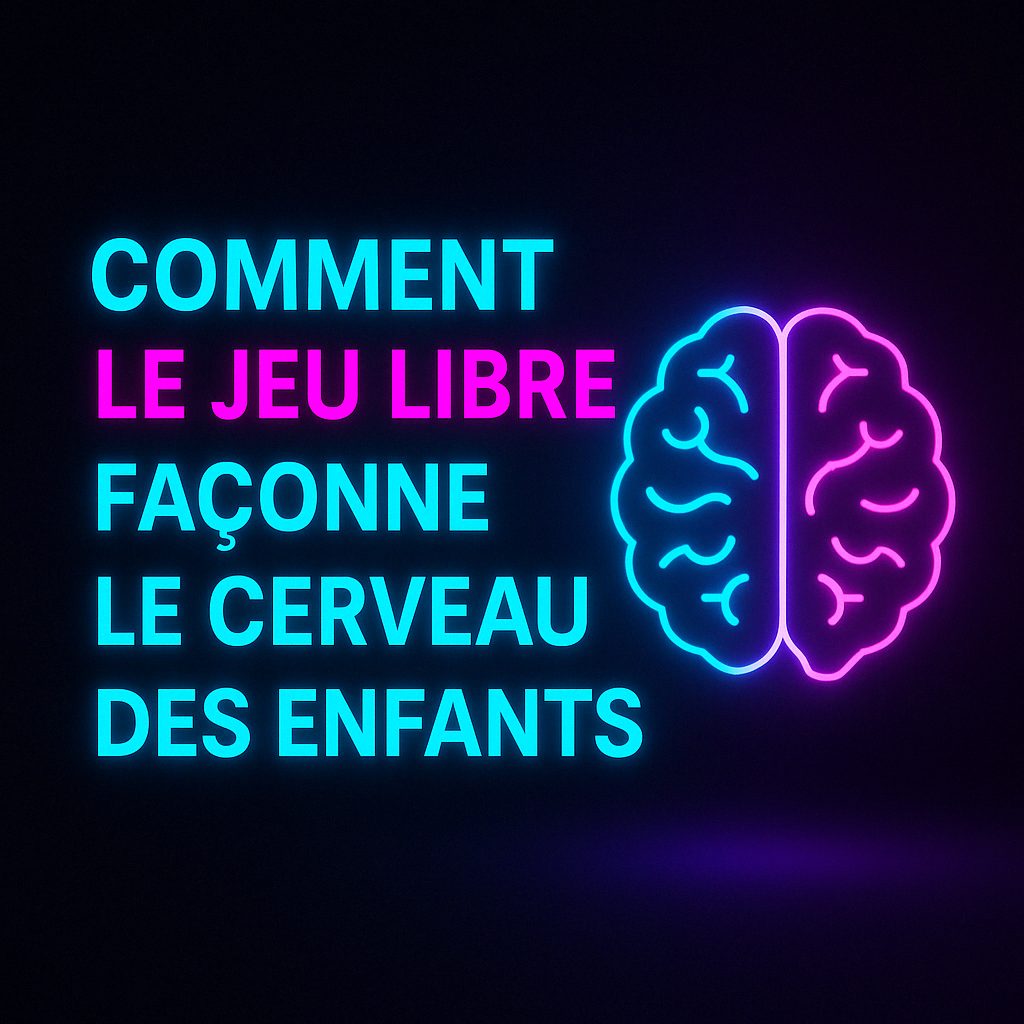
Comment le jeu libre façonne le cerveau des enfants
Ce que les recherches récentes nous apprennent sur le rôle du jeu dans le développement cognitif, émotionnel et social.
On a longtemps cru que le jeu, c’était du bonus. Une pause entre deux « vrais » apprentissages. Pourtant, les neurosciences, la psychologie du développement et les pédagogies actives nous le confirment : le jeu libre est un moteur essentiel du développement cognitif, émotionnel et social.
L’American Academy of Pediatrics (2018) affirme que « le jeu approprié au développement avec les parents et les pairs est une opportunité unique de promouvoir les compétences socio-émotionnelles, cognitives, langagières et d’autorégulation qui construisent les fonctions exécutives ». Le rapport insiste : « Le jeu n’est pas futile : il améliore la structure et la fonction du cerveau. »
Comme le rappelle le programme de l’école maternelle (BO 2015, réaffirmé en 2021), « le jeu libre participe à l’enrichissement des représentations initiales des enfants » et « constitue un passage indispensable car il autorise une exploration choisie par l’enfant lui-même ».
Apprendre à penser, à s’adapter… grâce au jeu
Fonctions exécutives et autorégulation
Le Harvard Center on the Developing Child est formel : « Pour les bébés et les tout-petits, les interactions ludiques simples avec les adultes aident à développer une architecture cérébrale solide, les fondations d’une santé durable et les bases de la résilience. »
Les recherches en neurosciences cognitives, notamment celles du Conseil scientifique de l’éducation nationale (CSEN), montrent que les enfants engagés régulièrement dans des jeux de rôle élaborés (inventer une histoire à plusieurs, se mettre dans la peau d’un personnage) développent une meilleure capacité à inhiber leurs impulsions, planifier des actions et réguler leurs émotions.
Ces fonctions dites « exécutives » sont cruciales pour la réussite scolaire et l’autonomie. Comme l’explique Stanislas Dehaene, « l’attention exécutive des enfants peut être entraînée de plusieurs manières : la pratique de la musique, ou de jeux informatiques très simples, où l’enfant est concentré sur un but bien précis ».
Des jeux de stratégie modernes comme les jeux coopératifs ou les deck-building games (adaptés dès 6 ans) renforcent également la flexibilité cognitive. Le programme ATOLE (Attentif à l’école) de Jean-Philippe Lachaux propose d’ailleurs des ressources concrètes pour travailler ces compétences.
En classe : Installez un coin « mini-scène » avec costumes, objets symboliques et liberté d’invention. Même 15 minutes de jeu libre par jour suffisent pour observer des effets positifs sur l’attention et l’autorégulation.
Stimuler la pensée, la créativité, les maths…
Pensée divergente et créativité
La créativité ne se décrète pas, elle se cultive. Les jeux ouverts, sans solution unique (Lego, Kapla, Playmobil, etc.), stimulent directement la pensée originale et l’invention de solutions nouvelles. Comme le souligne le document Éduscol « Jouer et apprendre – Cadrage général », ces jeux permettent aux enfants de « développer leur imaginaire, d’exercer des conduites motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés ».
Les recherches de la LEGO Foundation, en partenariat avec l’Université de Cambridge, confirment que « le jeu libre, ouvert et expérimental, est l’un des meilleurs moyens de stimuler l’apprentissage et la créativité ». Selon le Dr David Whitebread, « les enfants apprennent énormément de ce type de jeu où ils se fixent eux-mêmes des défis ».
Mathématiques et logique spatiale
Jouer avec des cubes, construire des labyrinthes, résoudre des énigmes ludiques… ces activités développent non seulement la compréhension des nombres et des formes, mais aussi la capacité à raisonner logiquement. Le document « Les jeux d’exploration » d’Éduscol précise que « l’ouverture à une pratique de jeux d’exploration exerce un effet catalyseur sur le développement du cerveau de l’enfant ».
Les travaux du CSEN confirment que les gains sont durables : « Les jeux sont un support idéal pour l’apprentissage des fonctions exécutives. Ils participent notamment au sens des nombres inné que les enfants ont avant d’apprendre à compter. »
L’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants (Université de Montréal/Laval) distingue le jeu libre — « auto-dirigé, volontaire, dicté par la propre motivation de l’enfant » — et le jeu dirigé, encadré par l’adulte. Les deux sont complémentaires : le jeu libre développe les compétences sociales et l’autorégulation, tandis que le jeu dirigé favorise l’acquisition de connaissances disciplinaires.
En famille : Un simple jeu de société type casse-tête logique peut devenir un vrai booster de raisonnement tout en passant un bon moment ensemble. Privilégiez les jeux sans écran !
Le cerveau en pleine transformation
Neuroplasticité et croissance cérébrale
Oui, jouer « fait pousser des neurones ». En particulier dans les zones de l’apprentissage social et de la régulation émotionnelle (hippocampe, cortex préfrontal, amygdale). Comme l’explique Catherine Gueguen, pédiatre spécialiste des neurosciences affectives, « Ce qui donne de la joie à l’enfant est bon pour son développement cérébral. Jouer, rire, s’amuser, grimper, courir sont indispensables et font maturer le cerveau ».
Les environnements dits « enrichis » – où l’enfant peut explorer librement, interagir avec des objets variés et faire des choix – activent fortement la neurogenèse (création de nouveaux neurones) et favorisent l’apprentissage à long terme. Dans ces moments, une molécule appelée BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) est sécrétée, favorisant la prolifération et la survie des neurones.
Conseil pratique : À l’école comme à la maison, variez régulièrement les jeux proposés, changez la disposition de l’espace, autorisez l’expérimentation. Le cerveau a besoin de nouveauté pour se développer !
Grandir avec les autres, s’exprimer, coopérer
Le jeu : un droit fondamental de l’enfant
L’Article 31 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant reconnaît le droit au jeu comme un droit fondamental. L’UNICEF rappelle que pour atteindre leur plein potentiel, les enfants ont besoin « d’opportunités d’apprentissage précoce et d’interactions de soin attentif — comme parler, chanter et jouer — avec des parents et aidants qui les aiment ».
Langage et interaction symbolique
Dès 18 mois, les jeux d’imitation enrichissent le vocabulaire expressif et la complexité syntaxique. Le langage utilisé entre pairs (sans adulte) est souvent plus riche en négociations, inventions et nuances. Les recherches de Tamis-LeMonda et collaborateurs (2023) confirment ces effets sur la croissance langagière des tout-petits.
Compétences sociales et coopération
Des suivis longitudinaux le confirment : plus un enfant a eu de temps de jeu libre avec d’autres, plus il développe d’aisance sociale et de capacités de coopération à long terme. C’est aussi dans ces jeux que se travaillent les codes sociaux, la gestion des désaccords et l’écoute active. Le programme de maternelle le rappelle : le jeu « favorise la communication avec les autres et la construction de liens forts d’amitié ».
L’International Play Association (IPA), reconnue par l’ONU et l’UNICEF, milite pour la protection du droit au jeu dans le monde entier et rappelle que « le jeu est communication et expression, combinant pensée et action ».
Jouer pour mieux gérer ses émotions
Réduction de l’anxiété et confiance en soi
Les jeux dits « risqués », encadrés mais libres (escalade, grimpe, jeux de vitesse), renforcent la capacité des enfants à identifier leurs peurs, les surmonter, et rester sereins face à l’inconnu. La revue systématique de Peter Gray (Boston College) montre que ces activités aident à développer un tempérament plus stable, sans accroître les blessures graves.
Peter Gray, auteur de Free to Learn, alerte sur le déclin du jeu libre ces dernières décennies et ses conséquences : « Au cours du dernier demi-siècle, le jeu libre entre enfants a fortement diminué. Sur la même période, l’anxiété, la dépression et le taux de suicide ont fortement augmenté chez les enfants et adolescents. » Selon lui, « le contraire du jeu n’est pas le travail, c’est la dépression ».
L’AAP (2018) confirme que le jeu agit comme un « tampon contre le stress toxique » : dans une étude, des enfants de 3-4 ans anxieux à l’idée d’entrer à l’école maternelle étaient deux fois plus soulagés après 15 minutes de jeu avec des pairs qu’après avoir écouté une histoire lue par un adulte.
À l’école : Aménager un parcours avec des éléments de hauteur, d’équilibre ou de vitesse contribue au développement émotionnel… autant qu’un atelier « philo » ou une séance de gestion des émotions.
Ce que disent les chercheurs sur la récré
10 à 20 minutes de jeu libre : un booster d’attention
Des méta-analyses récentes montrent que la qualité de l’attention des élèves est nettement améliorée après une pause de jeu libre non dirigée, même chez les enfants avec troubles de l’attention. Ces effets dépassent ceux observés après des cours de sport ou des pauses « actives » dirigées.
Les pauses actives constituent un complément intéressant : de courtes sessions d’activité physique (5 à 15 minutes) réalisées en classe, qui « contribuent à réduire les signes d’agitation et de distraction tout en générant des effets bénéfiques sur la concentration, la mémoire et la résolution de problème ».
À retenir : La récréation est une stratégie pédagogique, pas un luxe. Les pauses actives viennent en complément, mais ne remplacent pas le temps de jeu libre non structuré.
Jeu libre, numérique et IA : trouver l’équilibre
À l’heure où les écrans sont omniprésents, la question de l’équilibre entre jeu libre et numérique se pose avec acuité. Les recommandations officielles sont claires :
- L’OMS (2019) préconise au moins 180 minutes d’activité physique par jour pour les 3-4 ans, dont du jeu libre. « Ce qu’il faut vraiment faire, c’est remettre le jeu au centre de la vie de l’enfant. »
- Le Ministère de l’Éducation nationale rappelle qu’entre 3 et 6 ans, « il est essentiel de préserver le jeu libre, le contact humain, et le développement des cinq sens ».
- La CNIL propose des ressources pédagogiques pour sensibiliser les 8-10 ans à un usage raisonné du numérique.
Et l’IA dans tout ça ? L’UNESCO rappelle qu’un bon usage de l’IA en éducation suppose de « conserver l’humain au centre, de questionner les biais et de cultiver la réflexion critique, tout en valorisant les compétences de créativité et de jugement ». Le jeu libre développe précisément ces compétences que l’IA ne peut remplacer : créativité, coopération, gestion des émotions, pensée divergente.
Pour aller plus loin : jeprotegemonenfant.gouv.fr et Internet Sans Crainte.
Les 4 clés du jeu libre
Quelques repères concrets pour enseignants et parents.
1h de jeu libre par jour
École + maison cumulés. L’OMS recommande 180 min d’activité physique dont du jeu libre pour les 3-4 ans.
Jeux ouverts et collaboratifs
Jeux symboliques, de construction, de rôle… Pour la créativité, le langage et la coopération entre pairs.
Jeu risqué encadré
Grimpe, équilibre, vitesse… Développe confiance en soi et gestion de l’anxiété. Encadré ≠ dirigé !
Environnement riche
Varier les jeux, changer l’espace, autoriser l’expérimentation. La nouveauté active la neuroplasticité.
Références et ressources
Sources institutionnelles françaises
- Éduscol – Jouer et apprendre : Cadrage général (Programme maternelle)
- Éduscol – Les jeux d’exploration
- Réseau Canopé – CSEN et travaux de Stanislas Dehaene
- Réseau Canopé – Apprendre par le jeu (fiches pédagogiques)
- Programme ATOLE – Attentif à l’école (J.P. Lachaux, INSERM)
- Ministère de l’Éducation nationale – Bien grandir avec les écrans
- IFÉ – Institut Français de l’Éducation (ENS Lyon)
- Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik – Libre exploration éducative
Organismes internationaux de référence
- American Academy of Pediatrics (2018) – The Power of Play — Rapport clinique de référence mondiale
- Harvard Center on the Developing Child – Brain-Building Through Play
- LEGO Foundation – Learning Through Play (recherche internationale)
- UNICEF – Early Childhood Development
- UNICEF & LEGO Foundation – Learning through Play (rapport conjoint)
- OMS (2019) – Lignes directrices activité physique et jeu chez les moins de 5 ans
- UNESCO – L’IA en éducation : intégration éthique
- ONU – Journée Internationale du Jeu (11 juin)
- International Play Association (IPA) – Le droit au jeu de l’enfant
Encyclopédies et centres de recherche spécialisés
- Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants – Thème : Jeu (Université de Montréal/Laval)
- Encyclopédie CEDJE – Apprentissage par le jeu
- National Institute for Play (USA)
- Harvard EASEL Lab – LEGO Foundation Skills for Holistic Development
Ressources pour accompagner les usages numériques
- CNIL – Ressources pédagogiques pour les 8-10 ans
- Je protège mon enfant – Plateforme gouvernementale sur les écrans
- Internet Sans Crainte – Programme national de sensibilisation
Chercheurs internationaux de référence
- Peter Gray (Boston College) – Psychologie évolutive, auteur de Free to Learn
- Peter Gray – Blog Freedom to Learn (Psychology Today)
- Kathy Hirsh-Pasek (Temple University/Brookings) – Apprentissage par le jeu
- Roberta Golinkoff (University of Delaware) – Jeu et développement du langage
- David Whitebread (Cambridge University) – Jeu constructif, partenariat LEGO Foundation
- Peter K. Smith (Goldsmiths, University of London) – Éditeur thème « Jeu » Encyclopédie CEDJE
Références scientifiques françaises
- Dehaene, S. (2018). Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines. Odile Jacob.
- Gueguen, C. (2014). Pour une enfance heureuse. Robert Laffont.
- Cyrulnik, B. (dir.) (2019). Boris Cyrulnik et la petite enfance. Éditions Philippe Duval.
- Rochegude, A.-S. & Ruby, C. (2019). Libre exploration éducative. Institut Petite Enfance.
Références scientifiques internationales
- Yogman, M. et al. (2018). The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development. Pediatrics, 142(3).
- Gray, P. (2013). Free to Learn. Basic Books. (traduit en 18 langues)
- Gray, P. (2022). Decline in Independent Activity as a Cause of Decline in Children’s Mental Wellbeing. J. of Pediatrics.
- Lillard, A. S. et al. (2023). Pretend play and cognitive development. PMC.
- Tamis-LeMonda, C. et al. (2023). Joint pretend play and language growth in toddlers.
- Weisberg, D. S., Hirsh-Pasek, K. & Golinkoff, R. M. (2013). Guided play: Where curricular goals meet a playful pedagogy. Mind, Brain, and Education, 7, 104–112.

Laisser un commentaire